My dinner with André est un mille-feuilles mental à cinq plans : le calvaire d’un écrivain de théâtre qui dîne avec un metteur en scène atteint de narcissisme aigu, la souffrance attendrissante de cet homme torturé perpétuellement en quête, une expérience de complicité entre acteurs et spectateurs, la mise en scène culinaire de la domination bourgeoise, l’ouverture d’un espace de méditation socio-philosophique. Le plaisir du spectateur est protégé, interrogé et diverti par la circulation à travers ces cinq couches plus ou moins simultanées.
André est un metteur en scène au narcissisme océanique, qui parle sans cesse de lui, au point qu’il en oublie de manger, et empêche son ami, qui l’écoute très longuement, très patiemment, de lever le coude pour manger comme pour boire. Le contraste entre André et Wally, entre l’angoisse complaisante, stratosphérique et riche de l’un et le scepticisme rigolard, modeste, voire terre à terre, et bon vivant de l’autre, la lutte pour la maîtrise de son corps et de son territoire sur la table du restaurant, donnent lieu à une série de micro-gags tout à fait hilarants.
Si ce couple ressemble par moment au duo du Clown Blanc et de l’Auguste, cela ne les empêche pas de dire des pensées profondes et subtiles. Le rire, loin de nuire, loin de tourner en dérision, offre un espace de détente favorable à l’accueil de rêveries plutôt intellectuelles, portées sans insistance par ce dialogue entre un ange en errance et un ours trop humain.
De même, les moments ou les comédiens s’adressent au public en tant que comédiens et non en tant que personnages, loin de briser l’illusion du mentir vrai théâtral, parviennent à créer d’inestimables instants de sincérité. Tout se passe comme si la puissance de la perception scénique (l’obéissance psychique du spectateur à l’injonction de croire à la fiction du théâtre et du jeu) lissait ces moments de complicité avec le spectateur au profit de la crédibilité des personnages. Pourtant, ils sont en apparence une rupture du contrat spectatoriel : les comédiens commentent leur prestation, observent que, depuis qu’ils jouent ce spectacle, l’un grossit (celui qui écoute) et l’autre maigrit (celui qui monologue perpétuellement), etc. Mais, comme ils reprennent le jeu, sans pause ou sans marquer de rupture, le spectateur rassemble dans un tout cohérent, le plaisir théâtral, ces micro-déplacements. Cette fluidité tient à la permanence du jeu, le fait de tenir, à chaque seconde qui passe ou presque, le personnage comme un être vivant coextensif à son corps, à sa peau, à sa voix. Damiaan De Schrijver et Peter Van den Eede sont admirables. La truculence physique de l’un, le visage aérien et soucieux de l’autre, contribuent à l’impression d’une adhésion personnelle, intime, au personnage.
Dans l’entrelacs de cette double complicité, combative entre les personnages, de connivence avec le public, émerge un espace de pensée. Si le comique des récits est fréquent, si le stéréotype des égarements et des folies des grands artistes stratosphériques est un peu lassant, il reste que rien n’empêche de penser ces « stages » avec Grotowski et bien d’autres anecdotes comme une matière à réflexion. Plus largement, ce mélange – typique de la vie humaine quotidienne – entre le dérisoire et le profond est l’accueil juste pour des réflexions qui, sans cet environnement comique, seraient pontifiantes et d’un pénible sérieux. Les belles spéculations sur le peu de réalité du tabac du coin, qui ne sont pas sans rappeler le fameux poème de Pessoa Bureau de tabac, croisant celles sur New York conçu comme un camp de concentration, prennent une beauté légère qui en accroît la séduction.
La scène est double et rend visible une communication habituellement dissimulée. Le restaurant est un espace sévèrement clivé. La cuisine est le lieu du travail invisible sans lequel il n’y aurait ni nourrissage, ni dégustation, ni dîner, donc pas non plus de longue conversation rythmée selon les plats apportés par les serviteurs. La vie créative, les affres et les joies, l’élaboration, la critique, les échanges véhéments, tout cela est possible parce que, dans l’ombre, des travailleurs en préparent et en maintiennent les conditions d’existence. La chute du mur de la cuisine laisse apparaître le déni bourgeois du travail, déni qui est une condition de la jouissance. Faire réapparaitre ces conditions est un acte artistique autant que politique. Un spectacle réjouissant, nourrissant de joies les passions rabelaisiennes du corps et de l’esprit, un subtil mille-feuilles agréable et réflexif. À consommer patiemment.
Le Vif, Estelle Spoto (7/6/2018)
Le Soleil, éric Moreault (2/6/2015)
Le Soleil, Sophie Grenier-Héroux (30/5/2015)
Le Suricate magazine, Emilie Garcia Guillen (3/3/2015)
La Dépèche, Nicole Clodi (17/10/2014)
www.jeanjacquesdelfour.fr, Jean-Jacques Delfour (12/10/2014)
La Tribune (25/1/2007)
Le Monde, Fabienne Darge (9/11/2005)
Le pentagramme du plaisir théâtral
www.jeanjacquesdelfour.fr, Jean-Jacques Delfour (12/10/2014)
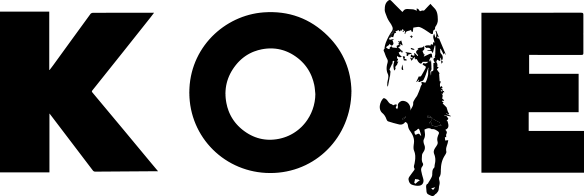
 Dans la presse
Dans la presse  Dans la presse
Dans la presse